Histoires, images de couvre-feu, de confinements, redéreconfinements, gestes barrière, sauts de haie, pinces–monseigneur, patchs, avec les autrices, auteurs et photographes de la revue et ouvert à toutes et tous
Vols de nuits n°1 / n°2 / n°3 / n°4 / n°5
Les pilotes de Vols de nuits
- Kader Benamer
- Bordomoncsi
- Emmanuelle Cabrol, Couvrez-vous et Feu qui couve
- Jacques Cauda, photographies, Loin, 21h et Ma moitié
- Pascale A. Chevereau
- David Colin
- Marie-Philippe Deloche
- Éolienne
- Françoise
- Laurence Fritsch
- Amélie Gahete
- Marie-France Lesage
- Claudine Londre
- Isabelle Minière, Mais déjà le ciel blanchit, Automne malade et adoré, Et que si c’est pas sûr, c’est quand même peut-être et Ne rentre pas trop tard
- Pauline Marzanasco
- Guylaine Monnier
- Thomas Pietrois-Chabassier
- Bertrand Runtz, Grand vent et Les corbeaux
- Valérie S
- Françoise Voland
- Angélique Gianolla-Martinez
- Sarcignan
- Ève Roland
- Lionel Laboudigue
- Mara
- Geneviève
- Marie des Neiges Léonard
- Abdelkader Benamer
- Lielie Sellier
- Paul Herail
- Armelle le Golvan, Neuves heures et Vol de nuit
- Olga Voscannelli
- Claire Janet
- Virginie Moiré
- René Leynaud par Albert Camus
- Hélène Berjon
- Florence White
Forbidden de sortir, d’aller chez l’autre, interdit. On n’a pas encore bien saisi et ressaisi la mesure de ce couvre-feu puis de ce deuxième confinement. Pourtant, les conséquences résonnent sourdement en chacun de nous. Le redoublement de la peur, à celle de l’épidémie s’ajoute celle de l’arbitraire aveugle. L’État ferme les commerces humains non nécessaires, mais dans le cloud et dans les mégacentres commerciaux continue le marché noir.
5e vol de nuit : samedi 16 janvier

Voleurs de nuit
par Guylaine Monnier
Il reste seul. Il écrase la cigarette, se brûle un peu les doigts, lèche la pulpe et sort à son tour tenter de la rattraper.
Elle a disparu. 18h approche. Il aurait aimé la voir à l’encoignure du quai. Il aurait aimé saisir sa présence, encore un peu, puis ne plus la voir et seulement alors, saisir l’absence. Peut-être aura-t-elle regardé dans sa direction avant de disparaître ? Il demeure ainsi, tourmenté par le manque. Tout aurait été différent s’il l’avait aperçue à l’angle. Il ne se serait pas senti subitement et profondément seul, avec cette peine coupable de l’avoir manquée.
Il n’avait jamais pris conscience qu’un défaut de moment puisse être aussi affligeant. De ces temps que l’on offre à d’autres – car un passant l’aura croisée, aura accaparé ce que seul lui aurait du voir, ce qui pour lui seul comptait, sans conscience ni mémoire ! Retrouver cet homme… cette femme… l’interroger. Demander combien elle était belle pour d’autres, comprendre l’expression de son visage alors, si elle regardait après elle avant de bifurquer ?
Un défaut de moment. L’expression le fait sourire. Il imagine un jeu de cartes, celle dont il faudra se défausser. Il tourne les talons. Après tout, chaque moment appartient à son temps, ce défaut de moment appartient déjà au passé. Il n’y a rien à faire, il ne pourra jamais le récupérer dans le présent comme dans le futur.
Cela aurait pu se produire ainsi. Mais en réalité, il ne fit pas demi-tour et continua de marcher. Au bout du quai, la femme ne l’attendait pas. Cette nuit-là, ce n’était pas seulement quelques instants que d’autres avaient volés. Mais la nuit même.Au bout de la rue, le jour l’attendait, il était 6h. Fin du couvre-feu.
Guylaine Monnier
Tenue du suaire obligatoire et marchand de sable
Détournement higelinien par Sarcignan

Cauchemars, fantômes et squelettes,
Higelin, Champagne
laissez flotter vos idées noires
Près de la mare aux oubliettes,
tenue du suaire obligatoire

marchand de 
sable
Acheter dix-huit heures, Kader Benamer
Au moment des aiguilles verticales où tout est diamétralement opposé,
machinalement, vous regardez l'heure. Des
erreurs vespérales comme une peur à tombeau ouvert se transforme en versets
croisés. La panique est en peine. L'insomnie sonne tôt ou tard. L'oeil du
prince est amnésique. Faut-il fermer ou ouvrir les portes ? Les seuils sont en crue. Le rêve du
dehors et les six doigts de la main

Mais déjà le ciel blanchit
par Isabelle Minière
Je ne savais pas comment m’habiller, ce matin ; aucun entrain, aucune envie de rien. Ça m’arrive parfois, quand je ne dois voir personne dans la journée, à part la dame de la boulangerie, l’épicier du coin. Dans ces cas-là, je m’inspire du temps qu’il fait. Le verdict de la météo était glaçant : environ zéro.
Zéro motivation pour choisir des habits. M’habiller comme la veille ? Ben non, j’ai déjà fait ça hier. J’ai regardé par la fenêtre, au cas où un brin de soleil…
Et là… Les toits tout blancs, le sol de la cour tout blanc.
Il neige ! Petits flocons tout doux qui voltigent dans le ciel, viennent se poser délicatement, blanchir, adoucir, égayer. Il neige ! Cette joie d’enfant, ce plaisir à regarder, regarder encore. Envie de sortir !
Où ai-je donc foutu ce pantalon blanc que je n’ai mis qu’une fois ou deux, avec l’impression d’enfiler un déguisement. Blanc avec des petits reflets qui scintillent un peu, comme des incrustations. J’avais l’impression d’être ridule dedans. Je l’avais acheté parce qu’il était soldé, cinquante pour cent de remise pour une bonne marque, raison idiote. Mais bon, voyons… Oui ! Au fond de la penderie, bien sage, attendant son heure. Bien repassé, en plus.
Il me va bien, je trouve, il est chouette, élégant, sobre. J’aimerais bien lui ressembler, dans le fond. Tee-shirt blanc, pull blanc, très doux. Écharpe blanche.
Je n’ai pas de manteau blanc, le mien est beige clair, ça ira.
Me voilà dehors, avec un sourire de gosse : marcher dans la neige, sentir mes pieds s’enfoncer dans ce si joli tapis. De quoi se consoler de ce putain de couvre-feu à dix-huit heures, de ce putain de virus. Non, quand même pas. Je reste inconsolable. Mais quand même, la neige !
Attention, ça glisse ! Je prends garde aux endroits où ce n’est déjà plus de la neige mais déjà de la gadoue.
La dame de la boulangerie est fatiguée, la neige ne change rien à sa fatigue, je lui souhaite bon courage, je sens qu’elle en a besoin. Quelle vie elle a, cette dame-là, quand elle ne distribue pas du pain et des gâteaux ? Je ne sais pas. Tous ces gens que l’on croise chaque jour ou presque, et dont on ne sait rien. Parfois on devine un peu. Cette dame n’est pas contente de sa vie, je crois.
L’épicier du coin a le sourire, il me lance : « T’as vu, la neige ? » Lui aussi, comme un gosse. On bavarde un peu, il est soulagé par le couvre-feu, ça lui permet de rentrer plus tôt. Je le comprends ; il bosse dehors, à vendre fruits et légumes, par tous les temps, par tous les froids. Puis il ajoute « De toute façon, j’ai pas d’amis, j’aurais nulle part où aller le soir après le boulot ». Je le plaisante : « Ben si : au théâtre, au cinéma, au restaurant ! » Il rigole, me dit « D’accord, on ira ensemble quand tout ça sera fini ! »
Je souris et je suis un peu triste aussi, comment ça se fait que ce type au sourire franc, à la bonne humeur si facile, n’ait pas d’amis ?
Mes achats sont faits, le décompte des heures commence.
Déjeuner avec les infos, toujours aussi réjouissantes. Pourquoi cet espoir, toujours le même, d’une bonne nouvelle ? Le virus fini, les gens guéris, et toutes les autres bonnes nouvelles qu’on attend depuis qu’on est enfant. On dirait que les gens qu’on aime ne peuvent pas mourir et qu’on serait heureux même quand il pleut.
Marcher. Rester dehors tant qu’on peut. Marcher de moins en moins dans la neige, de plus en plus dans la gadoue. Glisser, se rattraper, surveiller sa montre.
Trop de gadoue, la nuit qui tombe, le temps qui s’amenuise, froid aux doigts. Et puis ça sert à quoi de traîner sans but, sous prétexte qu’on a encore le droit ?
Dans le hall de l’immeuble, surprise.
Ils sont masqués tous les deux, je les reconnais grâce à leurs cheveux : longs et bruns pour l’un, blonds et longs pour l’autre. Mon voisin du premier, ma voisine du troisième. Leurs masques sont bizarres, blancs, avec des dessins… de fantômes. J’y connais pas grand-chose en fantômes, mais je crois que c’est ça. Ils pensent que c’est Halloween ? C’est vrai qu’ils sont fantasques, tous les deux… et qu’ils vont très bien ensemble. D’ailleurs ils disent la même chose :
– On t’attendait ! T’as vu l’heure ? Bientôt couvre-feu !
Ils sont de la police ou quoi ? Je souris sous mon masque, donc je souris avec les yeux.
– Viens boire un verre, manger un morceau avec nous, soirée Higelin ! Viens avec un squelette si tu en as un sous la main, c’est notre anniversaire : Champagne !
Ils sont nés le même jour… Je trouve ça si joli, comme coïncidence, pour des gens qui vont si bien ensemble.
J’y vais ! bien sûr j’y vais, tout en pensant à l’épicier, à la boulangère. Et à tous les autres.
J’y vais, tout en blanc, un immense sourire dessiné sur mon masque blanc. J’apporte ce que j’ai sous la main, pas de squelette disponible, ni de fantôme, juste quelques gousses d’ail qui déshonorent mon portail.
Amis, je vous remercie.
Isabelle Minière

le bal du couvre-feu, Pascale A. Chevereau
au soir où musent araignes
et chat noir de la duègne
le marchand des vesprées
a jeté par poignées
tous les grains qui picotent
les paupières papillotent
tous s’engluent sous le mors
de la petite mort
alors sonne le réveil
des miroirs vermeils
d’outre-tain ils se lèvent
incubes et leurs élèves
défroissent linceuls suaires
pour le bal de l’ossuaire
riches costumes endossés
brodequins loups chaussés
on chuchote on riote
on dansote on suçote
les fémurs déguisés
les crocs bien aiguisés
trois petits tours de rien
affûtent la soif la faim
trois petits tours des reins
et le nectar carmin
de draperies on sertit
les fenêtres, qu’aucun rai
ne gêne les revenus
lors du craque-squelettes !
4e vol de nuit : samedi 14 novembre
Puisque c’est à nous-mêmes de nous signer nos autorisations, un truc de fous. L’impression de vivre dans une fiction. Je m’autorise à faire une course, je m’autorise à faire une marche. Je m’autorise à penser ? La case n’est pas prévue.
Isabelle Minière, auteure de romans, nouvelles, livres pour enfants est la pilote de ce vol avec dans sa valise de confinée le mot distanceffraction.
Automne malade et adoré
par Isabelle Minière
Un reste de réflexe me revient parfois, m’approcher, tendre la main ; je me recule aussitôt, retiens ma main, use d’une formule triste et affectueuse, « Je vous serre la main de tout mon cœur… en pensée ».
Quand c’est quelqu’un de plus proche, c’est plus difficile d’être plus loin. Je t’aime beaucoup, mais à distance.
Comme si on se méfiait.
Oui, on se méfie, et si je transmettais la bestiole ? et si l’autre me la refilait, et si moi, ensuite je la refilais à d’autres ? Etc., etc., tout le monde sait ça. On est fatigué de le savoir. Mais on préfère quand même le savoir.
Par écrit, quel régal, de pouvoir écrire dans un mail, un message, Je t’embrasse, Je t’embrasse bien fort, Je t’embrasse fort ! Je t’embrasse de tout mon cœur. Et de le dire au téléphone, avec le son, l’intention, l’affection.
On se surprend à des témoignages d’affection. On se rattrape. Le virtuel pour compenser le réel.
*
S’éloigner ostensiblement quand on rencontre quelqu’un, garder la distance. En être parfois soulagé, pas besoin de prétexte, le plus souvent frustré. On aurait bien aimé un geste amical, une tape sur l’épaule, une bise sur la joue, une embrassade. Interdiction ! Comme un feu rouge qui s’allume dans le cerveau. Rouge, tu t’arrêtes.
C’est pas souvent vert, ces temps-ci. Le feu bloqué au rouge, un peu orange parfois, quand on s’autorise…
Ben oui, on s’autorise. C’est assez plaisant de décider que le feu est orange, même si c’est un orange un peu mûr. Et que donc, on peut encore passer, même si c’est limite. Puisque c’est à nous-mêmes de nous signer nos autorisations, un truc de fous. L’impression de vivre dans une fiction. Je m’autorise à faire une course, je m’autorise à faire une marche. Je m’autorise à penser ? La case n’est pas prévue.
C’est amusant d’imaginer les cases qu’on pourrait rajouter.
Je m’autorise à traverser au feu rouge parce qu’il n’y a pas de voiture à ce moment-là; je m’autorise à franchir l’interdit, parce que je me suis hyper bien lavé et relavé les mains, parce que je porte le masque, parce que j’ai trop envie de voir quelqu’un que j’aime, là, sur le trottoir d’en face, même si le feu est rouge.
Je respecte le code de la route du confinement, la plupart du temps ; j’ai acquis une bonne notion du kilomètre, une bonne notion de l’heure, une très bonne notion de l’attestation de secours, glissée dans ma poche, et qui me permet de marcher au-delà de l’heure. Ça me donne l’impression de passer au feu orange, quand il n’y a pas de bagnole sur la route – et pas de policiers non plus.
Je regarde la lumière, les jeux de lumière sur les immeubles, sur les voies ferrées, sur les feuilles d’automne, je ne peux pas m’empêcher de regarder les couleurs des feuilles, des arbres.
Je pense au poème d’Apollinaire Automne malade et adoré.
Surtout malade, cette fois-ci, pas tellement adoré.
*
Donc, je respecte – presque. Sauf que
Sauf que quoi ? Ce truc-là, qui chahute mes neurones, s’il m’en reste.
Si un ordre est rationnel, logique, argumenté, pas de problème. Si je traverse au rouge devant un camion, je suis en danger, l’ordre est logique. Et même si j’ai envie de me faire écraser, c’est pas du tout sympa pour le chauffeur qui aura mon écrabouillement sur la conscience. Donc stop, j’obéis au feu rouge, je m’arrête, je consens sans soucis.
Mais si je marche à distance de toute personne, avec un masque, au-delà du kilomètre, je ne mets personne en danger. Si ma santé mentale est, elle, en danger, à force de rester dans un petit endroit, sans balcon ni terrasse ni jardin, l’ordre me semble imbécile. Là, j’ai du mal. Obéir à un ordre illogique m’est difficile. Très.
Idem pour la durée de la marche, activité physique. J’ai entendu à la radio un psychiatre dire qu’il valait mieux marcher deux heures, à distance, sans risque, que de déprimer, voire se suicider. Ça, c’est logique ! merci docteur.
*
Quand j’entends que l’on doit être solidaires, tous, le mot me plaît bien, je suis d’accord. J’aide qui je peux, comme je peux, et certainement pas assez. Quand j’entends qu’être solidaire, c’est ne pas critiquer les mesures prises, la stratégie du gouvernement, là je me dis qu’on nous demande de ne pas réfléchir. De ne pas penser. Penser, encore un réflexe ! On préfère ne pas le garder à distance.
Isabelle Minière
J’irai toute seule
Marie-Philippe Deloche
Cosmos et chrysanthèmes
Cosmos et chrysanthèmes
Espèrent encore
Couleurs chaudes
Caresses humides
Ne m’arrachez pas de terre
J’irai toute seule
À mon tour
Le ciel ne me dit rien qui vaille
Crache ses nuages
Insulte la peau
Lutte contre le déclin de lumière
Je lutte contre le déclin de lumière
Laisse filer
Résiste à la chute des anges
Laisse tomber
L’horloge se désynchronise
Le cœur dit ses extrasystoles
Songes de fer
Enfer des rêves
Encore et encore
Laisse tomber
Encore déjà le soir
Laisse filer
Demain existera peut-être
Derrière la nuit
Si longue la nuit d’hiver
Qui vient déjà
Nous avons le pouvoir des filles
La ligne a la tonalité mélancolique
Horizontale
Des soirs d’hiver
Elle s’allonge, se couche sous un ciel vide
Nous avons le pouvoir des filles
Tout recoudre en écrivant,
Tout rythmer à petits points
Et faire onduler à nouveau
La ligne horizontale
Éclore des roses
Au bleu du ciel
Évidemment
Amélie Gahete
Évidemment, je me souviens du jeu : Saad avait mimé un avion. Nous avons cru que le pilote était rond. Je me souviens de l’après-midi passé à dessiner la bourrache indienne. Et je me souviens du fou rire géant.
Évidemment, je me souviens des devoirs faits ensemble, des entêtements durs comme le caramel et de la mauvaise foi mielleuse. Des colères. Je me souviens des bras tendus, des câlins soudains. Tant qu’on est dans les bras, la vie est éternelle.
Évidemment, je me souviens des premiers pas, du coucher de soleil l’été, du premier feu de bois, je me souviens même de sa main dans mon dos qui m’a lâchée parce que les roues roulaient, voilà je sais faire du vélo. Je me souviens de l’arbre à mémoire.
Ce soir, il ne reste que ça : un évidemment et tous les souvenirs. Puisque je ne peux plus toucher, te prendre à bras, te caresser te câliner, il ne reste que l’évidence de la mémoire. Et tu sais ? Eh bien, c’est fantastique, évidemment.
Loin
Peindre le loin. La distance qui me sépare de moi.
Je suis assis à ma table : tableau. L’atelier est plongé dans le calme. Aucun bruit. Des enfants parfois et les heures de Saint-Germain de Charonne qui sonnent. J’écris ce que je vais peindre.
Faire courir la main sur le papier les yeux clos. Rêver la ligne. Mon trait rompt le silence du blanc. Une trace immobile à grands pas, pour reprendre une formule célébrée.
Les feuilles sont encore toutes petites.
Les visages masqués comme en carnaval.
Une petite feuille ceinte de poils follets.
Telle la prairie pour l’ardeur.
Pétrir les choses avec des corps.
La fête du pire conviant le mieux.
Tomber des hommes comme des mouches.
Sensation douceur impression trouble vacillement murmure caché dans l’herbe savoir & entrelacs…
Je me dois à mon tenace démon.
Ça y est, la distance entre enfin en moi par effraction.
3e vol de nuit : samedi 31 octobre

La proposition d’écriture et photographie de Valérie Souchon :
« Une page arrachée au monde d’avant, vu d’ici. »
Au moment du déconfinement, on avait cru revenir au monde d’avant. Aujourd’hui, on a l’impression qu’on ne le connaîtra plus. Arracher à ce monde une page d’écriture, une photographie.


Grand vent
Cette nuit, un grand vent s’est levé,
Faisant claquer mes os dans mon sommeil.
Il a soufflé tant et plus,
Tant de feuilles aux arbres sont tombées,
Que ce matin,
Dans les sous-bois qui entourent la maison,
Impossible de m’y retrouver dans mes souvenirs.
Où es-tu ?
Deuxième jour du deuxième confinement
On n’ose pas dire second confinement, ça voudrait dire que ce sera le dernier – c’est pas sûr, mais c’est quand même peut-être !
Signer une attestation.
Ça m’avait fait tellement plaisir de déchirer la dernière. Je croyais alors que c’était l’unique confinement de ma vie. Comme quoi on se raconte les histoires auxquelles on a envie de croire.
Bordel de merde, je me suis dit, en essayant de rester polie. Putain, fait chier, en n’essayant plus rien, mais en signant.
Photographies avec les yeux, dans les rues de mon quartier.
Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ensemble, sans distance entre eux. Ils sont où les confinés ?
Beaucoup de masques, quand même – parfois sous le nez, comme si le virus était surtout sensible à la présence d’un flic dans les parages, le masque facile à remonter jusqu’au nez, en dernière minute.
Comme les parcs sont autorisés, cette fois-ci, à condition de rester à un kilomètre de chez soi, j’ai tenté le seul parc près de chez moi. Je le connaissais déjà, mais je l’évitais, je ne m’y sentais pas à l’aise.
Mercredi j’ai lu un article très intéressant sur ce parc, dans Charlie Hebdo. Qui confirmait l’étrange ambiance que j’y avais sentie, sans trop savoir pourquoi.
Avec Charlie, j’ai mieux compris. Merci Charlie. Crack, prostitution, trafic…
Donc, comme c’est dans le kilomètre autorisé, j’y suis allée.
Pas longtemps.
Ça s’appelle « Les jardins d’Éole », un bien joli nom.
Le dieu du vent a dû souffler trop fort, ou pas assez, ou pas comme il voulait. Ça souffle triste.
Je me suis sentie à nouveau mal à l’aise, seule femme dans ce parc. J’ai vu une famille ressortir après quelques pas – ils avaient fait comme moi, chercher le parc le plus proche.
J’ai laissé Éole souffler de travers. Triste. Triste pour les gens qui sont là, dans ce jardin, qui se débrouillent comme ils peuvent, pour survivre.
Quai de Seine, camionnette de flics, je rebrousse chemin. J’ai de mauvais souvenirs de contrôles lors du premier confinement, à cet endroit-là.
Barbès. Pas un flic, là où il y en avait en pagaille.
Je me rappelle une conversation sympathique, très imprévue, improbable, avec un policier qui m’avait contrôlée près du Louxor. J’avais pensé à la chanson de Renaud, J’ai embrassé un flic. Je l’avais pas embrassé, ce policier,faut pas pousser, mais senti de la sympathie.
Juste avant le re-confinement, j’ai vu l’expo consacrée à Renaud, à la Villette. Un plaisir, une nostalgie, une tendresse pour ce bonhomme-là, ces années-là. Les amis, dès que ça ré-ouvre, allez-y !
Après, j’ai sorti ma deuxième attestation, achats.
Je suis allée dire bonjour au marchand de fruits et légumes, le gars que j’aime bien, au marcher de l’Olive ; il n’a pas pu partir au bled cet été, il n’a pas pu ensuite, because pas de vol ou confinement obligatoire à l’arrivée à l’aéroport. Son pays lui manque, et sa famille. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur, il tient le coup, il garde le sourire, mais je le sens très triste, au fond.
Je ne sais plus si je vais acheter des fruits ou si je vais discuter avec lui. Les deux.
Il faisait si doux ce soir que l’on aurait pu croire que c’était le printemps.

Le premier
Jacques Cauda

Il fait un peu frais. Nous sommes bientôt en novembre.
Voici une femme en face de moi.
C’est la première fois. La première fois que je vois quelqu’un du monde d’avant.
C’est le matin et mon souffle palpite. Voici un rêve sur la jonchaie (son étendue, sa nudité).
Voici des yeux posés. Des yeux qui mangent le meilleur d’elle-même qui rêve du temps jadis.
Peu à peu, je vais devenir quelque chose, je commence à parler comme eux. Je deviens une bouche à humain.
La voici ! La voici où par ma bouche je mets des paroles. Elle secoue la tête.
En décembre, ce sera le temps des huîtres gris sable et des volailles luisantes. Mars avril, des jeunes pousses, des pois et des fèves vertes. Mai, de la noire morille et du veau translucide.
Je suis devenu un mot, maintenant on dit de moi voici l’AUTRE. Puis on se sauve. Je les vois courir effrayés.
Elle est tragique : les yeux toujours mouillés, les liquides se postent chez elle. Elle aussi, elle a peur ! Je sais qu’elle revoit le monde d’avant. Je lui vole ses souvenirs. Je me répartis le butin. Je m’en remplis.
Elle ne cesse de remuer les doigts, qu’elle tient recroquevillés les uns sur les autres. Des doigts d’amertume ? Des doigts qui tournent sans possession ? Des doigts mangés de verjus ? N’a-t-elle plus d’appétit ? Qu’étreint-elle ? Un petit morceau d’elle-même qu’elle ne veut pas oublier ? Elle est dans la solitude de l’inspirée. Elle pense à hier, elle revoit avant-hier, et elle se terrifie d’être aujourd’hui.
Je suis là. Je l’observe. Et plus je l’observe, et plus elle me fait penser à rien. Je suis en train de la vider. Bientôt, elle sera sans souvenirs. Elle n’aura plus ce bougé-immobile qui lui tourne encore un peu l’imagination. Cette vérité que remuait jadis sa mémoire encore toute chaude.
Maintenant c’est fini. J’officie. Je vide tout. Je fais d’elle un rien d’odeurs agréables.
C’est ainsi que je me parle, à la brisure de ses hanches. Où je me suis assigné.
Quelle douceur d’y songer. De la porter désormais comme une viande. Quelle douceur en tout. Comme des pétales de ouate aussi fins et imperceptibles qu’une pelure d’oignon. Un air tamisé, irisé, blanc épiploon, flotte sur ses seins et ses bras nus. Il y a aussi des bulles d’eaux savonneuses, fondantes et diffuses. Et un masque. Oui, tout est là et tout est accompli. Je suis le premier. Mais bientôt une multitude.
Jacques Cauda

Madou
par Françoise Voland
« T’as laissé tomber ton mouchoir, madame. » La fillette l’avait ramassé et tendu à Madou qui avait chancelé, tirée en laisse par son jeune chien. Un mouchoir brodé et repassé, sagement plié, d’humeur lavande. Remerciements. Ébaubissements. « Il est trop mignon, il s’appelle comment ? » La petite avait caressé le Jack Russell, lui avait fait des papouilles. Au bout de la laisse, Madou avait répondu, ravie. Le chien, c’est le passeport pour des conversations courtes et fondantes, des petits peu qui rompent la routine esseulée, les sourires qui s’échangent, les regards attendris sur le chemin de halage, entre le seuil et les besoins du chien, dans l’odeur d’herbes fauchées et de mer lointaine. Un des bonheurs quotidiens de ma voisine. Elle avait tendu le sachet de Napoléons qui l’accompagnait souvent, ces bonbons ronds, conquérants et acidulés.
Comment ça, elle a ramassé ton mouchoir, Madou ? Il y a bien longtemps qu’on ne ramasse plus rien dans les rues. Ni objets, ni effluves. La pensée de la contagion colle à nos semelles et presse nos pas. Les passants qu’on croise, leur présence est celle de l’ennemi. On n’ose plus humer l’osmanthe le long des remparts de Bruges : qui sait ce qu’on inhale dans l’air parfumé que ce type pâle vient de consommer ? Nos narines sont devenues des branchies en mode hors d’homme, qui se ferment en présence d’humain et s’ouvrent dans les absences. Madou, coquette et dans la peur de l’âge. Tu as cessé d’enduire tes lèvres de rouge : qui sait ce qu’il s’y colle, embusqué dans l’air musqué qu’une promeneuse vient de semer dans son sillage ? Tu gardes tes lèvres sous cape, ton nez sous anesthésie. Tu me le rappelles, Madou, c’était le long du canal, un jour que les feuilles des peupliers enflammaient l’automne.
Comment ça, elle a caressé ton chien, Madou ? Il y a bien longtemps qu’on ne cajole plus rien dans les rues. Accolades, bras dessus bras dessous, main dans la main, côte à côte. Chimères. Les mains sont lasses et lâchées, absentes, elles ont oublié les gestes tendres. Les épaules ont la nostalgie du côtoiement, du tutoiement, les bras pendent sans réconfort. Restent les baisers confinés. Chacun garde ses mains en poche, Madou, et ses bras au corps, et ses regards au loin, il y a de ces distances dans d’air qu’on ne parcoure plus. Je sais, Madou, c’était il y a un an à peine, le long du canal.
Et vous avez échangé un sourire, Madou ? Il y a bien longtemps que les regards se dérobent et que les masques confinent les rires. Des masques, nous en portons tant. Qu’on l’appelle IIR ou EFB, celui-ci est le masque ultime, celui qui cache les autres, cache les sourires de politesse ou de circonstance, les sourires crispés de l’aigreur. Bas les masques, il filtre l’air et les visages convenus. Au-dessus du masque, on ne voit plus que les vrais sourires. Ceux qui montent jusqu’aux yeux. Comme tes regards, Madou. Il ne nous reste plus qu’eux. Oui, tu me l’as dit, Madou, c’était il y a un an à peine, la gamine était repartie d’un pas dansant, la joue arrondie par le bonbon.
Aujourd’hui, les chemins sont déserts et l’activité emmurée, tu gardes tes sourires sous ton masque, Madou, et tes poignées de main dans tes poches, et tes baisers pour l’écran, et ton parfum pour la postérité, et ton rouge à lèvres pour jamais. Madou, fiévreuse et essoufflée, et qui a survécu, et qui se demande si l’enfer d’en bas n’est pas moindre que celui d’aujourd’hui.
Le moment venu, les bouches libérées, grimaces et rires, baisers à la ronde, souffles sur les peaux, haleines rafraîchies. L’humanité par la bouche, les langues qui se délient et se baisent, les peurs qui se délitent et se taisent. Les corps et les souffles qui se libèrent, dans l’air tiède, les bactéries qui dansent, mais qu’importe, on aura vaincu la Covid, même si la récession nous sourit, même si l’air trop chaud nous prédit déluges et déserts à notre seuil. Le long du canal, les feuilles des peupliers enflamment l’automne. Comment ça, Madou, plus jamais comme avant ?
Françoise Voland, le 31 octobre 2020 à 22h25, heure de Bruges
Un second samedi
Il est temps de ne rien faire à corps perdu et de saisir au vol l’immobile. Les fossiles clignent et des yeux. Sortant du sérail, suivant les sillons, ils dérobent les ténèbres. En comptant les absents, les ombres et les restes, même les moitiés ne feront pas la totalité. Il reste moins qu’avant. Dérobade, distraction. Par effraction, par effroi, elles volent en foule, la nuit. Par quel côté prendre l’horizon ? Demain la soustraction dominicale des heures légales devient une plue value.
Il est temps de ne rien faire à corps perdu et de saisir au vol l’immobile.
Abdelkader Benamer

Page mal tournée
Soudain mes pas disparaissent dans la pénombre et les feux d’octobre aux arbres se veulent sobres. La terre absorbe le bruit de mes semelles mouillées quand au cri de la chouette je suis déshabillé. Nue, dépossédée du temps que je pensais avant maintenant me voilà perdue sans accès à la nuit devant. Autour de moi tout devient absence comme un œil unique surveillant le silence. Où, comment cacher ma robe en attendant qu’entre les jours ma nuit ne se dérobe ? Aux façades closes scintillent étoiles et lettres de joie qui, telles deuils et larmes, glissent aux chaussées leurs reflets en sombres virgules de cafés noirs…
Paul Herail
2e vol de nuit : samedi 24 octobre

des colliers de bréchets
la mort s’est achetée une montre
rentre chez toi
ravale ton haleine
mange la soupe
habite la laine
avec une lampe électrique pour toute lune
ouvre l’abécédaire à la lettre C
une histoire où un virus porte bottes et bayonnette
dans un pays de tout petits enfants
portant des papiers froissés dans la poche
– les heures sombres sont prises de nausée
des amendes poussent sous la plante des pieds
rentre chez toi
niche dans la laine
mange ta soupe de poix
des plafonds fanés sur les épaules
puis fouille l’oreiller pour trouver des jambes fluides
on a confectionné des colliers avec des bréchets
coupé les veines du vin
bâché le soir
il n’y a plus de flamboyances à déclarer
et la honte ne sait pas brûler les joues des costumes de flanelle
est-ce le ciel ou l’œil qui est humide ?
le bétail toujours gangrène par la tête
Claudine Londre, Paris, 17 octobre 2020, 22h56
21h
21h c’est le couvre-feu
Me glisse sous la couverture
Envie d’écrire la couvre-ture
Bonheur de bonne heure
(Longtemps je me suis-je couché…)
J’entends le silence
Le blanc de la nuit du jour qui tombe
J’entends mon corps
J’entends le blanc de la fiction
Qui me divise
(Je recouvre Je)
Autant qu’il me réunit…

La proposition d’écriture de Stephan Ferry :
« Confiné à mi-temps, je divise par deux. »
Stephan Ferry
Et que si c’est pas sûr,
c’est quand même peut-être
Les gens qui dorment dehors ont compris que c’était le couvre-feu pour eux aussi. Pas la moindre pièce après vingt-et-une heure, même s’ils n’ont plus de montre depuis longtemps.
Les gens qui ne dorment pas dehors inventent des brunchs du soir, des goûters-apéro-dîner, à deux, trois, quatre, cinq ou six.
L’idéal c’est d’être copains avec ses voisins.
Les gens qui ne dorment pas dehors n’arrivent pas tous à dormir, bien au chaud dans leur lit, because cauchemars. Because la machine à penser qui ne s’arrête pas, pas programmée pour ça. Ou pas encore.
Les gens qui dorment dorment. Ne se posent pas la question. C’est ça la solution, ne pas se poser la question. Ceux qui ne dorment pas le savent déjà mais la question insiste quand même.
La réponse, c’est de dormir. Ceux qui ne dorment pas connaissent la réponse, et c’est encore plus énervant. Ça maintient éveillé jusqu’au petit matin.
Ceux qui rêvent font parfois des cauchemars, ce qui leur offre un grand soulagement quand ils se réveillent : la réa, l’intubation, c’était pour de faux – pour le moment.
Ceux qui font de vrais rêves, avec des fleurs, des gens qui les aiment, de la douceur, de la tendresse, ou bien un rien très calme, ceux-là se réveillent apaisés, reposés. Ça déteint sur leurs jours. Ça se voit à leurs sourires.
Ceux qui dorment dehors font parfois de vrais rêves, mais ils ne rigolent pas beaucoup quand ils se réveillent sur le trottoir. Quand même ça leur fait un souvenir, quand il fait trop froid, trop faim, trop désespérant. Peut-être.
Ceux qui dorment dans un lit imaginent ce qu’il se passe dans la tête de ceux qui dorment dehors. Ils n’ont pas tellement envie de comparer avec la réalité, imaginer c’est plus tranquille. Malgré les cauchemars.
Ce soir, en fin d’après-midi, elle achète une bouteille de vin dans un magasin, pour accompagner son dîner de couvre-feu.
Le vendeur la plaisante :
— Bon choix ! Je viens à quelle heure pour l’apéro ?
— Ben… vingt-et-une heures !
— Parfait ! comme ça, je reste jusqu’à six heures du mat.
Elle ne s’attendait pas à ça. Elle met une seconde ou deux avant de sourire, et de répondre « À tout à l’heure ! »
Dernier sourire avant qu’elle ne sorte de la boutique avec ses petits achats, le dîner d’un samedi soir, en temps de couvre-feu. Minuscule complicité, le temps d’un instant. Ça pourrait compter pour rien, ça compte.
Comme les pièces données tout à l’heure à celui qui dort dehors ; des vraies pièces, attention, des pièces de un ou deux euros. Ras le bol de voir des pièces de un, deux, cinq, dix ou vingt centimes dans les timbales des sans-abris. Que voulez-vous qu’ils fassent avec ça ?
Des vraies pièces, donc, en plus du sourire, en plus des quelques mots échangés. Les mots, un sourire, qui disent Tu es une personne, même si tu dors dehors. Ça compte.
C’est si peu. Ça peut, peut-être, changer un peu la couleur de la vie. Pour un instant. Et que si c’est pas sûr, c’est quand même peut-être.
Ma moitié
Jacques Cauda

Le noir bleu gris noir ciel chargé nuages vent douceur du temps qui divise le ciel, son corps est 2 pour moi, une façon de dire qu’elle est ma moitié, une manière d’être, babil de nuit, presque un bégaiement (hein + hein) pour rattraper ici un mot cher à Gilles Deleuze, bégaiement qui est aussi à l’œuvre chez Francis Bacon, et très explicitement dans le portrait qu’il a peint de cette femme coupée en 2. Ce même bégaiement du temps qui passe dans l’oscillation qu’il y a entre elle et moi, oscillation qui confine à l’hésitation balbutiante s’il ne s’agissait en fait tout simplement d’amour.
Jacques Cauda
Yakei ( paysage nocturne )
Ce soir,un écho dans la nuit qui tombe si bas.
je reste loin des croix et des fantômes.
Abasourdie par Le vide et L´ignorance.
Au milieu du pire on se raccroche à quoi?
J ´ai espéré mais Maintenant je sais.
Le ciel prend la couleur des matins glacés et du sommeil
Ce soir , un écho dans la nuit qui tombe si bas.
Avant quoi?
Des temps sans étendards cernés par le vide et l ´ignorance
Une petite mort et des orages sur nos visages .
Bientôt nous aurons tout oublié .
Et nous …
Ferions nous des rêves admirables ?
Verrons nous les prochain matins?
Le ciel et les étoiles tombent si bas
Au pays des couloirs et du crépuscule.
Des matins cernés par la folie.
Des batailles entre des chiens.
Angélique Gianolla Martinez


Neuves heures
Vingt-et-une heures au clocher
Neuves heures
La lune se résigne à ne s’éclairer qu’à moitié
En représailles, j’imagine
Je l’entends pleurer
Alors je m’obstine
À rêver doublement
Mais à cloche-pied
Et mes chimères coquines
Se font complices
De mon urgence dévoreuse de temps
Sur le noir lisse de la longue nuit
Je laisse aller mes jambes
Mes jambes seulement
Et mes bras envieux font de mon oreiller
Un piège à vœux
Mi laids, mi pieux
Armelle le Golvan
Vol de nuit n°1 : samedi 17 octobre de 21h à 6h

Couvre ta peau
ouvre la porte
compte les lits de l’hôpital
couvre la grogne
de l’infirmère
compte les cernes sous ses yeux
le nombre d’élèves par classe
couvre la guerre compte l’argent
couvre ta honte
de boue de poussière et d’orgueil
Couvre ta tête ou ces épaules
recouvre l’arbuste d’un voile
couvre la voiture d’une bâche
contre le gel
et dans la rue et dans la nuit
couvre l’enfant qu’il n’ait pas froid
comme ses parents sans couverture
couvre parole
couvre la voix de la misère
couvre les plaintes d’un linceul
Couvre ton corps
de la colère
ferme les bars
range les tables
et les couverts ferme les yeux
range ta rage
éteins les lumières de la scène regarde l’heure
et couvre feu
Valérie S., 17 octobre 2020, St Étienne
QUELQUE CHOSE D’OUBLIÉ
CE SOIR DE TOUS LES TEMPS
Thomas Pietrois-Chabassier, auteur dans Pourtant n°1
Quelque chose de vide
Et quelque chose de triste, de contraire, décimé,
D’amer,
D’oublié, déjà,
De sec, de froid, de sale, de foutu, tempétueux, fini,
Désarmement terrible,
Toutes les rues sont vides,
Quelque chose de pluvieux,
De venteux,
De l’hiver,
D’une brise, comme un ciel pleinement noir qui fait fondre le jour,
Quelque chose de demain,
Qui s’éteint lentement,
Déployé pour ce soir,
Ce soir de tous les soirs,
Ce soir de tous les temps,
Sur quelque chose de sombre, singulier, qui paraît s’avancer comme les
morts le font quand ils ne le sont plus,
Quelque chose d’effacé,
La promesse,
Qui sonne,
L’abandon,
Résignés,
Les corps qui se propulsent plus ou moins mortellement sur les lattes
craquantes d’un parquet où il ne faut pas être,
Sous les toits d’un appartement vide,
Au milieu des quartiers désertés,
Quelque chose de ce monde que, quoi, pourquoi,
D’un matin,
Sans plus rien,
Perdu,
Mourant,
Limite,
Crissée,
Les heures de quelque chose de ça,
Le calme dans la ville,
Comme le dernier râle,
Le souvenir d’un cri,
D’une nuit qui commence,
Qui avait commencé,
Qui ne finira pas,
Qui ne dansera pas,
Qui ne chantera pas,
Et qui ne dira rien,
Et qui ne donnera rien,
Plus rien,
Jamais plus rien,
Quelque chose de fragile, déposé là par quoi, comme le verre en argent
jeté dans la poussière,
Quelque chose de détruit,
Qui s’en va,
Qui s’en va,
Qui s’en fout,
Qui ne fera que ça,
Aller, partir, ne jamais revenir, aspiré par le temps d’une brise qui passait
sur la plage, dans la ville, et dans tous les bureaux,
Quelque chose comme on attendait pas,
Comme on ne savait pas,
Comme on ne savait rien,
Quelque chose de terne,
Quelque chose de facile,
Jamais sentimental,
Martial et mécanique,
Le pas des silhouettes en armes qui descendent du ciel,
Le calme dans les yeux,
Froids, morts, défaisant désormais sans couleur,
Le regard qui n’existe pas,
Dans l’amour qui n’existe plus,
Qui n’existera plus,
Les coeurs calcinés qui battent le rythme de la dernière charge,
Quelque chose de malade,
Qui va crever ce soir,
Qui te regarde encore,
Avec des yeux livides,
Avec des yeux tout plats,
La peau qui s’effrite,
Et l’oeil enseveli,
Le corps tout étendu,
Au milieu des draps blancs,
Qui parle une dernière fois,
Quelque chose d’aujourd’hui,
Qui finit,
Écrasé,
Quelque chose d’une idée,
D’une idée,
Laquelle, pour qui, comment,
Mais d’une idée cramée,
Brûlant sans particule de souffle,
Le filet de fumée finissante qui s’échappe des entrailles de quelque chose
de mort,
Gisant là pour toujours,
Comme pour la dernière fois,
Dans les courants d’une foule qui n’existera pas,
A jamais,
Pour souvent,
C’est maintenant.
In memoriam iuventutis nostrae

Les corbeaux
Comme surgis de la nuit, une nuée de corbeaux s’est abattue sur la forêt.
Je les ai vu s’enfoncer entre les troncs serrés des arbres, laissant derrière eux une hécatombe de feuilles d’or et de sang. C’est l’hiver qui approche, il tire à boulets noirs. Le combat s’annonce redoutable. Bientôt ses terribles armées de glace seront là. J’ai frissonné longuement.
Y survivrons-nous ?
Bertrand Runtz, photographe dans Pourtant n°1 et écrivain
Première heure des vacances
par Éolienne
Il est 17 heures à la sortie du Bois d’Aulne, c’est l’heure la plus libre puisque la première heure des vacances. Et c’est là que la nuit commence…
… pour toi, Samuel,
Qui avais l’habitude de poser à l’envers tes livres sur la table
Qui toujours avais du mal à passer les ponts
Qui préférais dire ouais
(ou ouais-ouais que tu trouvais plus gentil, aéré, moderne)
Qui avais depuis des mois abandonné l’idée d’un journal personnel
Qui avais de tous temps au fond du sac un parapluie
Toi, qui étais Charlie…
… Il me semble que toi et moi, on a déjà fréquenté le bureau de Poste de la rue Maurice Berteaux, la pharmacie, le fromager. Toi et moi vécu ensemble.
À la seconde de l’effroi quand tu vois s’approcher la lame, ton cerveau n’a pas le temps de fermer cette première pensée d’avoir oublié sur la table de la salle des profs ton Tupperware de midi, vidé et juste rincé, ni même cette deuxième pensée, quasi concomitante qu’à la rentrée du 2 novembre, tu pourras mettre au programme de ton cours l’étymologie du terme couvre-feu. À la seconde suivante, tes pensées roulent sur le trottoir, laissant gicler toute l’horreur de ton incompréhension.
Cette nuit, aux heures de couvre-feu, on devra réveiller le gars de la balayeuse municipale pour nettoyer et faire place aux roses blanches sous cellophane, nounours et roudoudous que tes petits élèves viendront déposer là en se demandant qui fera histoire-géo après les vacances. Il est 17 heures au Bois d’Aulne, c’est l’heure la plus libre puisque la première heure des vacances.
Éolienne, 17 octobre

Jack London avait son First & last chance saloon, à Oakland. Un siècle plus tard, à Bordeaux, j’étais pilier de bar au Last chance, rue des douves. Comme Lavilliers, je voulais savoir pourquoi toutes les nuits j’attendais un jour de plus, un grand amour, une folie, avant de repartir seul au petit matin, dans les poubelles (Extérieur nuit, 1986). Avec Léo Ferré, je pensais qu’il convient de rencontrer les autres quand ils sont disponibles, devant un verre, à certaines heures pâles de la nuit. Avec des problèmes d’hommes, des problèmes de mélancolie (Richard, 1973). J’y ai laissé de l’argent, des illusions, des neurones. Mon foie. J’y ai rencontré des paumés aussi paumés que moi, et d’autres qui l’étaient bien plus et sont morts depuis. J’y ai parfois — rarement serait plus exact — trouvé du sexe, jamais de l’amour.
Fermer à 21 h ces lieux d’errance immobile, de discussion inaudible, de poème fracassé et de gloire rêvée, c’est tuer Villon, Verlaine et Bukowski, sans compter quelques chanteurs, acteurs et peintres. C’est ce qui m’a donné l’idée de détourner un tableau de Hopper, dont j’ai eu la chance de parcourir dernièrement l’exposition à la fondation Beyeler, à Bâle. Nighthawkers (1942), sans ses oiseaux de nuit et avec un barman masqué et solitaire, c’est le négatif de la nuit telle qu’on l’aime.
Sarcignan, photographe dans Pourtant n°1 et chroniqueur dans le hors série Pandémie
Où
Dis-moi, Blaise, sommes-nous loin de demain
dis-moi, Guillaume, quand sonnera l’heure enfin
de sortir à point d’heure
dis-moi, Jacques, où boire encore un verre et aimer ses amis
et toi, Boris, dans ton caveau de Saint-Germain-des-Prés
le saxo ne chante plus
qui l’a cassé, qui te l’a pris — dis-moi
Je pense, répond Blaise, aux trains qui roulent
et nous emportent loin de la nuit, loin de demain
je pense, répond Guillaume, à la Seine
qui coule sous le pont Mirabeau même à minuit
— la Seine —
je pense, répond Jacques, à cette rue autrefois si heureuse et si fière d’être rue
qui se voile aujourd’hui de silence et de mort
et moi, répond Boris, je pense
à Gréco la prophétesse
qui s’est enfuie avant que la nuit disparaisse.
Ève Roland, auteure dans Pourtant hors série Pandémie
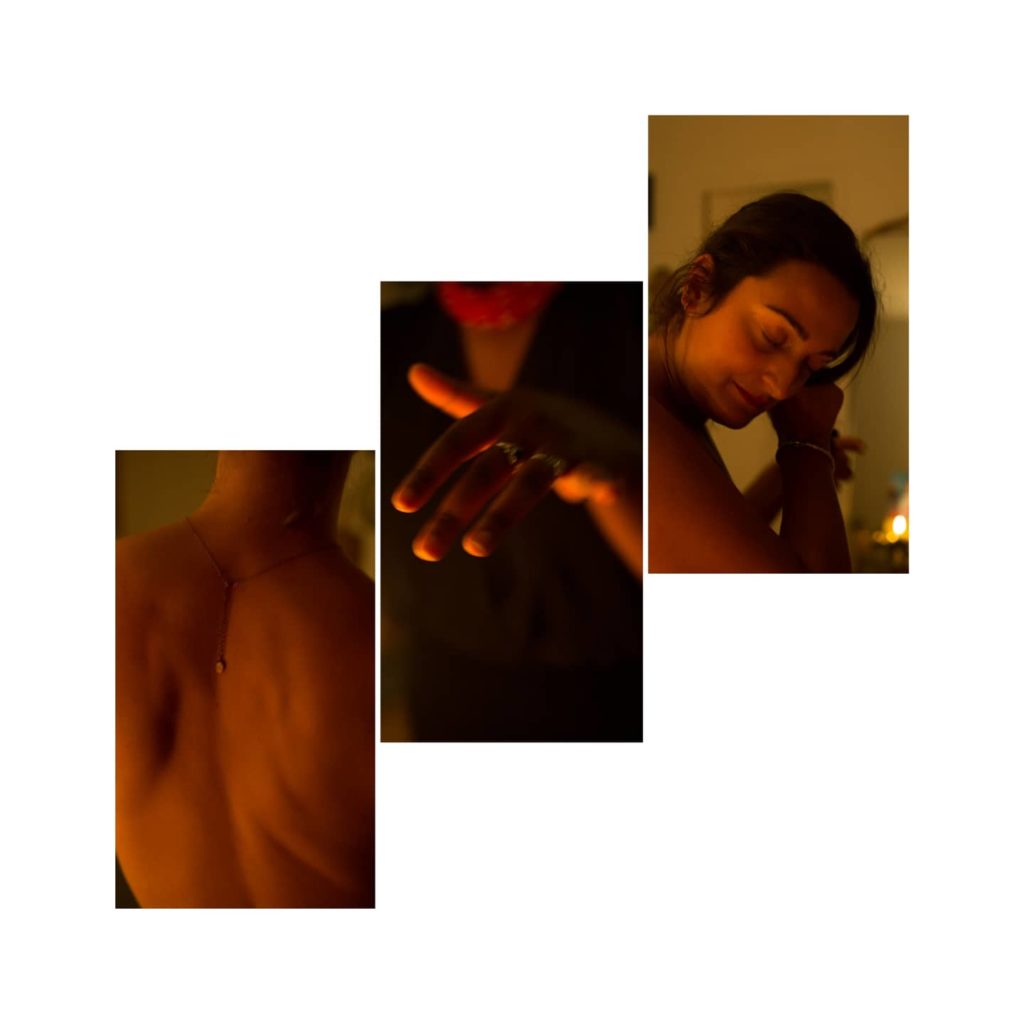
Couvrez-vous
Le soir tombe
Couvrez-vous le froid plombe
Les pierres des ruelles
L’ombre assombrit les cieux
D’un linceul irréel
L’heure est au couvre-feu
Les gens rentrent chez eux
Et la nuit est si belle
Couvrez-vous
C’est l’automne
Entend. Le vent fredonne,
Siffle dans les venelles
L’obscurité prend place
Et la nuit est si belle
Les amoureux s’enlacent
Tout se tait sur la place
Un arbre bat des ailes
Couvrez-vous
Découvrez
Qui vit au fond de vous
Découvrez vos fêlures
Et pansez vos blessures
Il est temps que s’emmêlent
Les vérités nouvelles
L’heure est au couvre-feu
Les gens restent chez eux
Et la nuit est si belle
Feu qui couve
Je guette ton pas dans l’allée.
J’allume
Des bougies unes à unes
J’émince et j’enfume
Une pluie de légumes
Je me parfume
M’enroule dans un costume
De plumes
Le feu du désir se rallume
Au couvre-feu
Je guette ton pas dans l’allée
M’affaire
À mettre le couvert
Argenterie, belles cuillères
En lierre
Un chemin d’école buissonnière
Je lève mon verre
Rien n’est plus comme hier
Le feu du désir s’exaspère
Au couvre-feu
Je guette ton pas dans l’allée
C’est l’heure
Le vin décante avec bonheur
Quelques lampes chassent les peurs
Vingt et une heures
Tu rentres enfin de ton labeur
Je meurs
De tout ce désir qui m’effleure
Le feu du désir affleure
Au couvre-feu
Emmanuelle Cabrol
Ne rentre pas trop tard !
Couvre-toi ! disent les parents attentionnés, ou bien qui font semblant de l’être. Mets ton manteau, ton gilet, ton bonnet, ton écharpe… Trop de choses à mettre sur soi. Ça donne envie de sortir tout nu dans la rue. Non, ça donne surtout envie de sortir comme on veut. Tout nu, on n’irait pas très loin, et on n’aimerait pas ça, de toute façon. Tout nu, ça sera à un autre moment, sous la douche, dans son lit, son canapé, son tapis, peut-être avec quelqu’un
Surtout ne prends pas froid, dit Léo Ferré pour la vie. Oui, il nous dit ça pour la vie, Léo, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Je pense à lui quand j’ai froid dehors : j’aurais dû mieux l’écouter. Parfois, je ne me couvre pas assez, pour le plaisir de me souvenir de lui.
Automne, malade et adoré, c’est Guillaume qui dit ça ; quand il y a de l’automne dans l’air, il y a de l’Apollinaire. Il y a ce bouquet de feuilles, ce bouquet de couleurs, qu’un jour d’octobre j’ai cueilli pour quelqu’un ; quelqu’un qui ne pouvait pas marcher, voir toutes ces couleurs, ni le ciel, ni les odeurs de l’automne.
Il y a souvent beaucoup de gens dans ma tête.
Guillaume et Léo, j’avais rendez-vous avec eux ce soir.
Je voulais faire la fête, jusqu’à pas d’heure. Il faisait si doux, dans mon coin, presque l’été indien. Guillaume n’était pas d’humeur, il avait un truc à écrire, Léo n’était pas d’accord, il a insisté : Ne rentre pas trop tard !
Bon, ben les amis, si vous me lâchez, je vais traîner en solitaire, dans le quartier. Le quartier indien. Sauf que c’est plus l’été.
Les restaurateurs sont en train de ranger les tables, de nettoyer, de baisser le rideau. Les gens qui sortent du métro marchent à toute vitesse, certains regardent leur montre, comme s’il y avait urgence. Tous des médecins ? Tous des urgentistes ?
Je regarde la mienne, de montre. Vingt-heure et cinquante minutes.
Je me souviens, oui je me souviens si bien. Et si mal, parce que ça fait mal parfois de se souvenir. Je me souviens bien de ce qui fait mal.
Je me souviens, le couvre-feu, c’était pendant la guerre. J’étais pas là, mais on m’a raconté. Pas beaucoup, mais un petit peu. Les sirènes, les caves pour se cacher pendant l’alerte. La peur. Combien de morts ? Sortir de la cave, sortir de sa cachette et se demander : Combien de morts ? Qui est mort ? Est-ce que mes proches sont encore vivants ? Est-ce qu’ils sont blessés ? Est-ce qu’ils sont en danger ?
Il y a une cave dans mon immeuble, mais je n’ai aucune envie d’y passer la soirée, même s’il y reste quelques bouteilles.
C’est quand qu’on est bombardés ?
J’entends pas de sirènes, je vois des policiers.
Bientôt vingt-et-une heures et je n’ai pas de laisser-passer. Il n’y a pas non plus de Gestapo. Justes des flics qui font leur travail.
Je rentre à ma petite maison. C’est pas une maison, mais j’aime bien l’appeler comme ça. Je pense à ceux qui n’en n’ont pas, de petite maison, de toit sur leur tête. Ils aimeraient bien, c’est sûr, rentrer chez eux à vingt-et-une heure, ça voudrait dire qu’ils ont un toit. De quoi je me plains ?
De ne pas me sentir libre. De retomber en enfance, où l’on me disait ce que je devais faire. Pas apte à en décider, pas responsable. Ce n’était pas « Ne rentre pas trop tard », c’était autoritaire, c’était « L’heure c’est l’heure ! » Sinon, le bâton.
Le bâton, ça fait pas réfléchir, ça donne juste envie d’y échapper.
Pas vu, pas pris.
Vingt-deux heures, j’ai envie de sortir, juste pour voir.
En reportage, pour ainsi dire. Il ressemble à quoi, mon boulevard, maintenant ? Il a l’air de quoi, mon quartier indien, à part l’air triste ?
Nan ! me dit Léo ! Sois sage. Surtout ne prends pas froid. Il est déjà tard.
Keep cool me chuchote Guillaume, car il parle anglais.
D’accord, les amis.
J’ai un truc à écrire, moi aussi. Un livre à lire. Des choses à penser. Des choses à rêver. Des choses à dormir.
Rien faire aussi.
Tout à l’heure, bien plus tard, après le truc à écrire, le livre à lire, je couvrirai le feu. Éteindre le feu pour la nuit pour éviter l’incendie. J’éteindrai l’ordinateur, la lumière. Je fermerai les yeux.
Et je penserai à vous.
Léo, Guillaume, et vous tous, que j’emmène avec moi, dans la tête, dans le cœur, tout ça. On sera nombreux à s’endormir, on rigolera bien tous ensemble, et on se foutra bien de la gueule du couvre-feu.
On fera un très beau rêve. Le même rêve, tous ensemble.
Un rêve où on dirait que.
On dirait qu’il n’y a jamais eu ni virus ni couvre-feu.
Un rêve où on rêve.

Couvre-feu à contre-courant /// 21h30
cette nuit
je te saute
au cou
dans le tumulte étouffé des villes
là où les éreintés sont retenus
je refais les gestes qui donnent du courage
et mes mains tremblent
de jouir d’y croire encore si fort
déconcertée d’être cette humanité
qui semble reculer à genoux
je te promets pourtant que nous sommes bien pire
que ce feu couvert par cette armée de chiens galeux
nous sommes des corps qui chargent
nus
fragiles
acharnés
dans l’obscur et contre lui
et l’odeur est merveilleuse
nous sommes la poudre !
Mara
Nous n’en pouvions plus
Nous avions eu ordre de déserter la nuit : son ampleur, sa faconde, son insolence, sa dissipation, ses terreurs. Son allégresse, sa tristesse nous étaient interdites. Tabou de la nuit. Honte de la nuit. Porteuse du pire. 21 heures sonnantes. Trébuchantes. Soûlantes. Nous ne pouvions plus contempler les lumières, écouter les sons, humer l’air du fleuve. Il nous fallait rentrer chez nous au plus vite.Nous ne pouvions plus retrouver une âme esseulée, un soir, juste parce que ce soir là on se sentait vide, mais vivant, prêt à mordre la vie, mais comment mordre la vie, seul ou en visio-conf ?Nous ne pouvions plus, la nuit tombée, nous retrouver entre potes, au restau, dans un bar, dans la rue, chez quelqu’un, à deux, trois, quinze ou trente, jusqu’à plus d’heure, parler, s’engueuler, picoler, surveiller l’heure du dernier métro, ou pas, légers, un peu défaits, heureux de cette dissolution, de cette ouverture au néant, que nous approchons à petits pas. Nous ne pouvions plus claquer la porte de notre dernier amoureux, celui qu’on vient de rencontrer, qui nous plaisait tant, et puis non, cette nuit-là, ça le fait pas, on veut rentrer chez nous, on en a assez, on ne peut pas rester une minute de plus, il faut respirer, marcher, se retrouver ailleurs, vite !Nous étions assis, désormais, dans le jour. Condamnés à la lumière, au propre, au décent.
Nous n’en pouvions plus.
Geneviève




Vol de nuits, Marie des Neiges Léonard
La taille des jeunes
Les hommes
Déterrent leurs tombes à coup de
Montres l’hilarante rengaine
Des aiguilles noyées sec
Un coup de digestif c’est l’aube qui trinquera
Les ombres étouffées des néons convoités
Ne serrent plus la taille des jeunes aux lèvres fraîches
La coupe débordante devra s’éteindre ce soir
Et sous le regard morne des lampadaires pendus
Les nuques des matraqués font bien risible proie
Dans le silence sirop des tueurs de poètes
Ne brille plus que l’intarissable voix
D’un rossignol fantasque au matin tôt levé.
Claire Janet


Les rideaux
C’est un souvenir sorti de la mémoire d’un petit garçon, né le 21 novembre 1939, dans l’Orne en Normandie.
Il avait été placé en pension comme on disait alors, dans une institution religieuse tenue par des religieuses, à Sées. Il ne rentrait chez lui que pendant les vacances avec sa soeur Paulette et son frère Roger ses aînés. Leur mère, abandonnée de son mari, avait dû se résoudre à cette solution trouvée par ses patrons. Ses trois enfants devaient l’entraver dans son rôle de cuisinière d’une maison bourgeoise, la maison du Dr Voulmier.
Ce souvenir, il le portait depuis ses 4 ans peut-être, avant son départ en pension ou lors de brèves vacances qui l’arrachaient au sadisme des religieuses dont les méfaits l’avaient torturé sa vie durant.
Ce soir-là, la nuit était tombée sur la ville et la grand rue d’Alençon. La pauvreté devait être tenue à distance par la chaleur maternelle malgré les privations et l’opprobre familial qui désignait cette femme sans mari.
Des coups impérieux frappés à la porte à cette heure incongrue, avaient glacé l’atmosphère du foyer. La mère, Fernande, était allée ouvrir, incertaine et inquiète. Aux yeux du petit garçon, un homme immense encadrait la porte. La terreur, c’était celle de mon père qui s’entendait encore dans les inflexions de sa voix lorsqu’il nous racontait cette histoire.
L’homme, sanglé dans son uniforme martial était venu pour que soient mieux fermés les rideaux des fenêtres donnant sur la rue. C’était le temps du couvre-feu.
Virginie Moiré, auteure Pourtant n°1 et hors-série Pandémie
Vol de nuit
Ce soir mon cœur danse
Contre les barreaux d’ivoire et de sang
Et il en rit
Trop vivant
Trop gourmand
Ce soir mon cœur chante
Quand les rues sourdes et obéissantes
S’offrent au souffle muet de la nuit
Mais mon cœur entend
La lune et ses mutants
Les âmes libres
Alors il s’élance
Discrètement
Et il rebondit de cratère en firmament
Explose en éclats d’argent
Lèche les étoiles
File avec les comètes
Ravive les rêves
Et mon cœur étincelle de joie
Ce soir, il te cherche, toi
Dans cette première nuit
Première fois
Puisqu’on ne peut pas
Il me la doit
Notre rencontre hors-la-loi
Cette nuit mon cœur s’en balance
Du vide d’en bas
Il sang-gourmande de toi
Et je m’en lèche les doigts
Mon cœur compte tes heures
Rejoue l’enfance
Et le noir s’épuise
En cris et farandoles
Lentement la brume gomme
L’empreinte de ta voix
Alors
Dans le silence
Mon cœur glisse sous la froideur des réverbères
Et dans le jour timide
Se terre
Armelle Le Golvan



Leynaud et Camus

« J’ai souvent logé, en 1943, lors de mes passages à Lyon, dans sa petite chambre de la rue Vieille Monnaie que ses amis connaissaient bien. Leynaud en faisait les honneurs brièvement puis sortait des cigarettes d’un pot de grès et les partageait avec moi. Dans mon souvenir, ces heures là sont restées celles de l’amitié. Leynaud, qui allait coucher ailleurs, s’attardait jusqu’à l’heure du couvre-feu. Autour de nous, le lourd silence des nuits d’occupation s’établissait. Cette grande et sombre ville du complot qu’était alors Lyon se vidait peu à peu. Mais nous ne parlions pas du complot. Leynaud d’ailleurs, sauf nécessité stricte, n’en parlait jamais. Nous nous donnions des nouvelles de nos amis. Nous parlions quelques fois de littérature. Mais à cette époque, il n’écrivait rien. Il avait décidé qu’il travaillerait après.[…] Pour Leynaud, tout était simple, il reprendrait sa vie où il l’avait laissée, car il la trouvait bonne. Enfin, il avait un fils à élever. Et lui qui s’animait rarement, le nom de son fils suffisait à faire briller ses yeux. »
— Albert Camus, préface de Poésies posthumes par René Leynaud, 1947 (épuisé)
Porte ton masque, Jeanne
La Covid. Juste une grosse grippe, elle ne passera que l’hiver. Ne porte pas de masque, Jeanne, tu n’en as pas besoin.
Les cafés ont fermé. Les poignées de main ont cessé. On s’est confinés et le blé continue à pousser. Porte ton masque, Jeanne, porte ton masque et tout ira bien.
Les gens ont battu la campagne. Et la marée n’a cessé de battre le sable. La respiration a continué. Mais chez certains, les poumons ont cessé. Porte ton masque, Jeanne, porte ton masque et tu iras bien.
Les embrassades ont cessé, les sourires ont disparu derrière les cotonnades et les masques stériles. Stériles nous sommes devenus. Orphelins de cœur et de corps et les mains délavées jusqu’à la souffrance. Mais moi, je te veux, je te cherche. Porte ton masque, Jeanne, porte ton masque, il te va bien.
Cette nuit, les rues ont disparu, retournées comme un gant, vide et vides. Et mon sang continue à battre et à tourner dans mon corps et la terre continue. Et j’ai la tête qui tourne au tournesol et le sang au miel. Trouve-moi, embrasse-moi. Porte mon masque, Jeanne, porte mon masque, il te va bien.
Et tu m’as touché et tu m’as aimé. Et tu t’es couchée, chaude et dolente. Ôte ton masque, Jeanne, ôte ton masque, rien ne va plus. Fiévreuse et essoufflée.
Et je tourne en toupie, le masque en bannière, le regret inutile, les mains vaines et vilaines, le cœur en quarantaine à perpétuité Je porte ton masque, Jeanne, je porte ton masque, tu n’en as plus besoin.
Françoise, le 17 octobre 2020, 21h44 heure de Bruges
Liberté chérie
Liberté chérie
Manteau noir bien raccourci
Au loin l’arme à feu
Hélène Berjon

Automne
Pourtant a lancé durant la 1ère nuit de couvre-feu du 17 octobre 2020 ce
Vol de nuits
Nouvelles, récits, poèmes
Chacune, chacun a écrit — entre 21h et 6h — histoires, nouvelles et récits, poésie, suscitée par ou évoquant ce couvre-feu.
C’était en direct sur un tableau en ligne, un « pad », en l’occurrence Framapad, outil libre, gratuit, indépendant des Gafa et de l’État.
Photographies
Chacune, chacun publiait une ou des photographies autour de ce couvre-feu sur son compte Instagram avec la mention @pourtantpourtant
Publication
Le comité de lecture de Pourtant opère une sélection dans ces envois.
Au sein de cette sélection sont choisis un texte (nouvelle ou récit), un poème et une photographie pour être publiés dans le prochain numéro papier de la revue (n°2, parution décembre 2020) et sur ce site pourtant.fr
Les autres textes et photographies de cette sélection sont publiés sur le site www.pourtant.fr dans ce hors série « Vols de nuits ».








